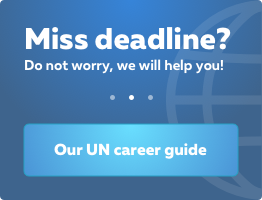Result of ServiceRéalisation efficace et dans les délais de tous les résultats et produits (« outcomes and outputs ») du projet dans les limites du budget disponible, grâce à un renforcement des orientations techniques, à une amélioration des capacités de mise en œuvre et à une meilleure assurance qualité, notamment grâce à une unité de gestion de projet compétente, motivée et fonctionnant efficacement. Work LocationÀ domicile Expected duration12 mois renouvelable Duties and ResponsibilitiesCadre organisationnel ONU Environnement est la principale autorité mondiale en matière d'environnement. Elle définit l'agenda environnemental mondial, promeut la mise en œuvre cohérente de la dimension environnementale du développement durable au sein du système des Nations unies et défend avec autorité l'environnement mondial. Son mandat consiste à coordonner l'élaboration d'un consensus sur les politiques environnementales en surveillant l'environnement mondial et en portant les questions émergentes à l'attention des gouvernements et de la communauté internationale pour qu'ils prennent des mesures. La division des écosystèmes d'ONU Environnement travaille avec des partenaires internationaux et nationaux, en fournissant une assistance technique et un développement des capacités pour la mise en œuvre de la politique environnementale, et en renforçant la capacité de gestion environnementale des pays en développement et des pays à économie en transition. Contexte L'Union des Comores est un petit État insulaire en développement (PEID) situé dans l'océan Indien. Les effets du changement climatique sont visibles sur l'ensemble des îles, avec une augmentation des températures annuelles moyennes, une modification des régimes de précipitations (diminution des précipitations annuelles, mais augmentation de la variabilité et des événements extrêmes), ainsi qu'une élévation du niveau de la mer. Avec 2/3 de la population vivant à moins de 2 km de la côte, les communautés sont particulièrement vulnérables aux impacts du changement climatique tant du côté marin (élévation du niveau de la mer, phénomènes météorologiques extrêmes) que du côté terrestre (changement des schémas saisonniers, phénomènes météorologiques extrêmes) : le changement climatique augmente l'insécurité alimentaire, l'insécurité hydrique et l'insécurité du logement, avec un effet d'entraînement sur le développement économique car l'agriculture et la pêche restent les principales activités génératrices de revenus. Ce projet \"Renforcer la résilience climatique de la zone côtière des Comores par une adaptation basée sur les écosystèmes\", d'une durée de 60 mois, vise à réduire la vulnérabilité des communautés côtières comoriennes au changement climatique (141 541 personnes) en restaurant, protégeant et gérant durablement 6 200 ha d'écosystèmes terrestres et marins d'une manière économiquement viable, durable et intégrée qui fournit des services écosystémiques protecteurs, régulateurs et productifs. Cette approche permettra d'accroître la sécurité alimentaire, hydrique et économique des populations côtières comoriennes dans un contexte de changement climatique. En particulier, l'accent mis sur les approches EbA dans le contexte de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) permettra de réduire ou d'éliminer les pressions qui sapent la capacité des communautés et des écosystèmes à se remettre des chocs climatiques, et d'accroître la résilience des populations à mesure que les conditions climatiques changent. Cela se fera par le biais de quatre composantes. • Environnement favorable à la mise en œuvre de l'EbA dans les zones côtières : le projet soutiendra l'élaboration de huit plans de développement municipaux de manière participative, sexospécifique et résiliente au climat, en utilisant l'EbA et des approches de GIZC. Les capacités de 10 000 membres de la communauté seront renforcées et un système participatif de suivi de l'adaptation des zones côtières sera mis en place. • Restauration et amélioration de la gestion des écosystèmes côtiers pour la résilience climatique - les activités favoriseront la gestion participative et la restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et marins interdépendants, à savoir les mangroves, les plages et les bassins versants. • Favoriser la participation du secteur privé à une économie bleue résiliente au climat - les activités comprennent le soutien à 300 MPME engagées dans des pratiques et des innovations intelligentes sur le plan climatique et liées à l'EbA, grâce à l'utilisation de programmes d'incubation/d'accélération et à des possibilités de microfinancement. • Gestion des connaissances et apprentissage - les activités comprennent le soutien au dialogue et au partage des connaissances/expériences entre les parties prenantes régionales, nationales et locales. Les avantages du projet en matière d'adaptation comprennent des avantages liés à l'exposition (grâce à la restauration des écosystèmes côtiers), des avantages liés à la sensibilité (grâce à l'amélioration des pratiques terrestres) et des avantages liés à la capacité d'adaptation (en fournissant des pratiques alternatives, des activités génératrices de revenus et en soutenant le développement du secteur privé). Le projet vise à réduire la vulnérabilité des communautés côtières comoriennes au changement climatique en restaurant, protégeant et gérant durablement les écosystèmes terrestres et marins d'une manière économiquement viable, durable et intégrée qui fournit des services écosystémiques de protection, de régulation et de production dans le contexte de la GIZC. L'entité d'exécution du projet est la Direction Générale de l'Environnement et des Forêts (DGEF). L'Unité de Gestion du Projet (UGP) est située et travaille administrativement sous la supervision de la DGEF et rendra compte à la DGEF. L'UGP est composée d'un chef de projet (CP) qui dirige l'UGP, d'un spécialiste du suivi et des rapports, d'un spécialiste des questions de genre et des sauvegardes et d'un responsable administratif et financier, d’une assistante de projet, d’une chargé de communication et des responsables insulaires pour chaque iles. Le CP rend compte au directeur du projet, qui est le directeur général de la Direction de l'environnement et des forêts (DGEF). L'agence d'exécution du FEM est le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). Le montant total de la subvention du FEM pour la période de cinq ans de ce projet est de 8 925 000 USD. 2. Objet et portée de la mission Le Conseiller technique principale (CTP) soutiendra le chef de projet (CP) dans la coordination, la planification et l'exécution globales du projet afin de garantir la réalisation de tous les résultats et produits du projet, ainsi que des objectifs correspondants. Le CTP soutiendra la préparation des termes de référence des consultants et des prestataires de services et procédera à l'examen de tous les projets de livrables du projet. Le CTP soutiendra également l'unité de gestion de projet (UGP) dans la gestion globale du projet - y compris les plans de travail, les budgets, les exigences en matière de rapports, les termes de référence, etc. et assurera également la coordination technique de ce projet d'adaptation basé sur les écosystèmes des zones côtières. L'UGP est l'unité chargée de la gestion quotidienne et de l'établissement de rapports sur les activités du projet. Le CTP veillera à ce que la mise en œuvre du projet réponde à des normes techniques élevées et s'aligne sur les attentes du PNUE/FEM en matière de qualité et sur les garanties environnementales, sociales et de genre. Le CTP soutiendra l'examen des résultats techniques, assurera la cohérence entre les composantes et renforcera les capacités nationales pour la mise en œuvre, le suivi et l'établissement de rapports sur le projet d'adaptation intégrée des zones côtières. Le CTP travaillera en étroite collaboration avec le CP et l'équipe de l'UGP, ainsi qu'avec le spécialiste du projet d'adaptation pour l'Afrique du FEM/GCF du PNUE, basé à l'unité d'adaptation au changement climatique de la division du changement climatique de la branche adaptation et résilience, à Nairobi. Le CTP effectuera au moins deux missions aux Comores par an. Tâches et responsabilités spécifiques Le CTP entreprendra les tâches suivantes en soutien au directeur de projet, à l'UGP et au directeur national du projet : A) Soutien à la gestion de projet : • Soutenir la direction dans la mise en œuvre du projet, suivre l'avancement des travaux et, avec l'aide du chef de projet, veiller à ce que les résultats et les rapports soient fournis en temps voulu et dans le respect du budget. • Conseiller et soutenir le fonctionnement efficace de l'UGP. • Assurer la supervision technique afin de garantir la cohérence, la qualité et la solidité scientifique de toutes les composantes du projet et de tous les produits livrables. • Superviser les liens logiques entre les résultats du projet, les indicateurs de résultats et les activités connexes. • Soutenir le chef de projet dans l'identification des synergies et des chevauchements avec d'autres projets cofinancés. • Contribuer à la supervision de l'expert en suivi et évaluation pour la mise en œuvre d'un système complet de suivi et d'établissement de rapports. • Examiner les plans de travail des projets, les plans d'approvisionnement, la gestion du budget et les rapports et y apporter une contribution substantielle. • Orienter les réponses en matière de gestion adaptative sur la base d'un suivi régulier des risques, des résultats et des enseignements tirés. • Soutenir l'alignement stratégique des résultats du projet sur les politiques et cadres nationaux, du FEM et du PNUE. • Participer aux réunions du comité de pilotage du projet, aux événements d'échange de connaissances et aux réunions de coordination technique. • Faire des recommandations au CPS pour une mise en œuvre et une coordination efficaces des activités du projet, ainsi que des conseils stratégiques sur les approches EbA, la gestion côtière et l'intégration dans les plans/stratégies locaux (de développement). • Encadrer et former l'équipe de l'UGP et les homologues nationaux à la gestion, à la mise en œuvre, au suivi et à l'établissement de rapports sur les projets. • Le cas échéant, conseiller le chef de projet dans le travail de liaison avec les partenaires du projet, les organisations donatrices, les ONG et d'autres groupes afin d'assurer une coordination efficace des activités du projet. • Informer immédiatement la DGEF et le PNUE de tout problème ou risque susceptible de compromettre la réussite du projet. • Effectuer d'autres tâches dans le cadre du projet, à la demande du chef de projet, du directeur du projet et du spécialiste du projet d'adaptation pour l'Afrique du FEM/GCF du PNUE B) Soutien à l'adaptation basée sur les écosystèmes des zones côtières : • Soutenir la préparation et l'examen de la qualité des termes de référence (TdR) pour les consultants et les prestataires de services. • Aider à l'identification, à la sélection et au recrutement de consultants et d'experts, le cas échéant. • Fournir une analyse et une contribution aux versions préliminaires et finales de toutes les activités et de tous les résultats du projet. • Conseiller et soutenir les aspects techniques généraux de toutes les composantes du projet, y compris, entre autres, la mise en œuvre d'évaluations de la vulnérabilité climatique, d'activités de restauration et de stratégies d'engagement du secteur privé. • Conseiller et assurer l'intégration d'approches écosystémiques menées localement et tenant compte de la dimension de genre dans toutes les composantes du projet et tout au long de son cycle. 3. Suivi et contrôle des progrès Les principaux résultats attendus sont les suivants : En rapport avec l'aide à la gestion de projet : • Contribution régulière à l'élaboration et à l'examen des plans de travail et des budgets annuels et semestriels, des rapports financiers et des plans de passation de marchés conformément aux étapes de la mise en œuvre du projet. • Préparation et/ou examen écrit de la qualité des ordres du jour des ateliers et des produits de la connaissance. • Examiner et fournir des contributions techniques sur le matériel de communication et les notes d'information politique élaborés dans le cadre du projet. • Contribuer par écrit aux principaux rapports de projet, y compris les rapports annuels de mise en œuvre du projet (PIR), les rapports semestriels sur l'état d'avancement et les mises à jour des bailleurs de fonds. • Au moins deux rapports de mission par an, résumant les conclusions techniques, les recommandations et les actions de suivi. • Contributions stratégiques et techniques et participation aux réunions du comité directeur du projet (CDP), y compris les briefings et les présentations. • Des rapports consultatifs semestriels du CTP décrivant les progrès de la mise en œuvre, les défis techniques et les mesures correctives recommandées. • Fourniture de commentaires/révisions dans le cadre du suivi des changements sur les différents documents travaillés, en incorporant les contributions de diverses sources, y compris du PNUE. • Conseils techniques et assistance au chef de projet (CP) et à l'unité de gestion de projet (UGP) pour toutes les composantes du projet. • Procès-verbal de la réunion de coordination de l'UGP. • Note d'information évaluant la cohérence des éléments du cadre logique, y compris les liens entre les activités, les indicateurs et les objectifs, et recommandant des ajustements pour soutenir la gestion adaptative. • Note technique identifiant les synergies avec les initiatives d'adaptation cofinancées ou parallèles aux Comores, y compris les recommandations pour la collaboration ou l'alignement des ressources (par exemple, formation partagée, indicateurs harmonisés). • Section des rapports consultatifs semestriels du CTP consacrée à l'analyse des risques, aux enseignements tirés et aux mesures d'adaptation proposées pour l'ensemble des composantes du projet. • Plan d'action succinct de renforcement des capacités et mémo de mise à jour semestrielle documentant les séances de coaching, les compétences transférées et les lacunes en matière de capacités comblées. • Note succincte après les principales réunions de coordination ou missions conjointes, résumant les réactions des parties prenantes, les possibilités d'alignement et les problèmes de coordination. • Registre des problèmes tenu par le CTP et partagé mensuellement avec l'UGP et le PNUE, signalant les risques liés à la mise en œuvre et les mesures d'atténuation proposées. En rapport avec le soutien à l'adaptation basée sur les écosystèmes des zones côtières : • Documents écrits (par exemple, les termes de référence des consultants, les notes d'information). • Examiner par écrit les projets et les résultats finaux produits par les consultants et les prestataires de services, y compris un retour d'information technique clair et des recommandations. • Rapports de mission résultant de visites sur le terrain dans les sites de projet et de la participation à des réunions techniques avec les parties prenantes du projet, les prestataires de services et les bénéficiaires. Ligne hiérarchique Le CTP rendra compte à la chef de l'unité d’Adaptation au changement climatique du PNUE, en collaboration avec le spécialiste du projet d'adaptation en Afrique du FEM/FVC (PNUE) avec un accompagnement de la cheffe du projet et du directeur national du projet \" Qualifications/special skillsUn diplôme universitaire supérieur (maîtrise ou doctorat) en sciences de l'environnement, gestion des ressources naturelles, adaptation au changement climatique, gestion intégrée des zones côtières ou dans un domaine connexe est requis. Au moins dix ans d'expérience professionnelle progressive, dont au moins cinq ans dans la mise en œuvre de projets liés à l'adaptation au changement climatique, à la gestion des écosystèmes côtiers, à la gestion intégrée des zones côtières ou à des projets connexes, sont requis. Une expérience professionnelle avérée au sein d'une équipe multidisciplinaire d'experts et de consultants est requise. Expérience avérée dans l'élaboration ou la mise en œuvre de projets financés par le FEM ou d'autres donateurs est un atout Familiarité avec l'intégration de la dimension de genre et le respect des garanties environnementales et sociales du FEM est un atout Expérience professionnelle antérieure dans la planification, le suivi, le reporting et l'évaluation de projets est un atout Expérience dans le domaine de l'engagement du secteur privé est un atout Expérience professionnelle dans ou avec les petits États insulaires en développement (PEID) est un atout LanguagesLangues (obligatoire) : La maîtrise du français et de l'anglais (écrit et parlé) est requise. La capacité à rédiger des rapports techniques, à communiquer avec les parties prenantes et à faire des présentations dans les deux langues est essentielle. Additional InformationNot available. No FeeTHE UNITED NATIONS DOES NOT CHARGE A FEE AT ANY STAGE OF THE RECRUITMENT PROCESS (APPLICATION, INTERVIEW MEETING, PROCESSING, OR TRAINING). THE UNITED NATIONS DOES NOT CONCERN ITSELF WITH INFORMATION ON APPLICANTS’ BANK ACCOUNTS.
Conseiller technique principal (CTP)
- Added Date: Friday, 29 August 2025
- Deadline Date: Wednesday, 10 September 2025
- Organization: United Nations Environment Programme
- Country: Kenya
- City: Nairobi
- Post Level: Unspecified
-

This vacancy is archived.